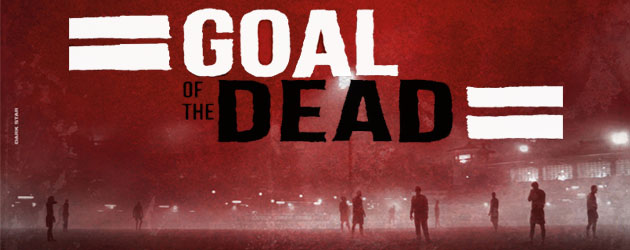Enfin les dieux sont avec nous et sur grand écran !
Dire qu’on attendait ce film ne serait qu’euphémisme tant la folie qui ronge les fans (dont je fais partie) est toujours plus maladive. Economiquement, Saint Seiya est le Star Wars japonais ! Mangas et animés ne sont que la partie émergée de l’iceberg. Le nerf de la guerre est constitué des produits dérivés à n’en plus finir, toutes ces figurines vintage, ces Myth Cloth, Myth Cloth EX, gashapons… Le tout dans chaque version des armure de chaque personnage, de chaque médium… Cette saga a toujours réussi à se relancer grâce à de nouvelles séries de mangas conduisant à d’autres animés et films, et toujours sous la houlette du seigneur Masami Kuromada, Ô le grand créateur qui ne peut se séparer de son univers infini. De quoi se perdre dans toutes ces constellations !
Mais voilà, Saint Seiya Legend of the Sanctuary, le sixième de la saga, est le premier qui se démarque de tout ce qui a été produit jusqu’à présent : C’est un reboot du meilleur passage de la saga originelle, celui où, pour sauver Athéna, l’équipe des chevaliers de bronze traversent le Sanctuaire en affrontant 12 chevaliers d’or. Donc pas d’inquiétude si des termes comme « Pegasus Ryu Sei Ken » ou « Crystal Wall » ne vous disent rien, le long métrage s’adresse plus aux profanes qu’aux fans !
Cette fois, Kuromada, producteur, s’est personnellement impliqué dans la création du film, comme c’est à la mode ces derniers temps pour les auteurs de manga Shonen (One Piece, Naruto, Dragon Ball Z…).
Aussi, le film est en image de synthèse, et donc extrêmement attendu au tournant ! Je ne voyais pas d’objection surtout que ces beaux combats aux pouvoirs merveilleux et aux armures complexes méritaient bien des plans totalement libres. Et ça fonctionne ! Les textures des armures, les reflets, les expressions, le pari est tenu. Malheureusement, rien de bien transcendant surtout quand un certain Albator est passé par là un an avant. Et soyons honnête, le film ne fait même pas rougir Final Fantasy Advent Children sorti il y a 10 ans. Mais l’enjeu est tout autre. Animer de pareilles armures est extrêmement difficile surtout qu’elles sont très nombreuses. Les scènes d’action sont fluides, les mouvements bien lisibles et niveau spectacle, le film vaut le détour. Mention spéciale pour les impacts et les nombreux détails comme l’usure des armures.
Le film bénéficie également d’une bande originale qui soutient parfaitement l’action tout en restant dans la lignée des symphonies de Saint Seiya. Lorsque vous découvrez un magnifique Sanctuaire suspendu avec de pareilles musiques au cinéma, c’est le frisson garanti !
Vous l’aurez compris, techniquement ça tient la route. Maintenant je vais prendre le taureau par les cornes : Ce n’est pas le film qu’il fallait faire !
Déjà, une heure trente c’est bien trop court ! Le passage du Sanctuaire avait 73 épisodes à lui seul ! Cette erreur, on la doit au George Lucas du manga, Kuromada, refusant la demande du producteur de faire deux heures. Ça laisse donc peu de place pour raconter une histoire qui se veut aussi épique. Du coup, telle « l’Excalibur » du Capricorne, on tranche dans la bobine ! il faut foncer, pas le temps de s’offrir des envolées lyriques, on enchaîne les explications et l’action puis on bâcle TOUS les personnages !
Et là c’est impardonnable ! Saint Seiya fait partie de ces rares séries qui proposaient des personnages ultra charismatiques appelés à devenir des références pour les séries à venir. Ce concept génial de la hiérarchie, des codes couleurs et autres pouvoirs faisait rêver au point qu’on s’identifiait tous à un signe ou à un des caractères. Tout n’était pas parfait, et souvent l’auteur allait tellement loin que ses archétypes devenaient des stéréotypes. Mais fallait lui accorder que ce mélange subtil de mythologie grecque, de Sentai et de Shonen apportait une magie nouvelle ! De plus, le passage du Sanctuaire, alors repris dans moult mangas tel que Bleach, relevait du génie ! Et ce chara-design de Shingo Araki qui surpassait de loin celui de l’auteur… Tout était sublime, bien que long, trèèèèèèèès long !
Avec Saint Seiya Legend of the Sanctuary, c’est l’inverse, le temps est tellement compté que les rares combats contre les chevaliers d’or s’enchaînent très vite. Et quand je dis rares, c’est parce que vous ne les verrez pas tous se battre, voire, vous verrez une attaque ici ou là. On ne peut donc même pas trouver agréable de fait que ces affrontements soient plus rapides tant la frustration reprend le dessus fréquemment. Idem pour leurs maisons qui servaient à leur exposition, ici pas le temps de s’y attarder (ha, les pauvres fans de la Vierge, des Gémeaux ou du Poisson). Vous l’aurez compris, la sacralisation des signes et des guerriers, on s’en cogne !
Seul Seiya est à peu près « caractériel », c’est un d’jeun qui fait son excentrique. Wouahou ! A la rigueur Shiriyu, parce qu’il ne veut jamais enlever son armure… Bon ok c’est nul, mais pour le reste, c’est le néant ! Même Athéna n’est plus qu’une gourdasse qui passe son temps à être étonnée et à exprimer la même onomatopée de surprise… Elle offre même un final qui vous fera baisser la tête tellement elle est peu crédible ! D’ailleurs on ne ressent pas du tout cette peur de mourir qu’elle devrait avoir après s’être fait transpercée par une flèche… Surement parce qu’elle N’EST PAS SOUFFRANTE OU DANS LE COMA ! Où est réellement l’enjeu ? Où sont les émotions ?
Mais bon, fallait bien une dose féminine qui reste tout le long pour rendre ce film plus accessible.
Vous allez me dire que je reste trop dans la nostalgie avec mes comparaisons à deux balles… Ok j’exorcise mon côté vieux schnock… c’est vrai que le film cible vraiment les ados actuels, Seiya est donc plus fun, le métrage est beaucoup plus dynamique et plus High Tech tant les armures sont désormais dans des pendentifs… Non mais voilà une autre blague ! Si les chevaliers portaient leur Pendora Box, c’était pour exprimer le poids de leur armure ! Ainsi le respect s’imposait par le mérite ! Mais cela renvoi à un autre manque cruel dans ce film qu’est la volonté de toujours se dépasser. On revient toujours au timing, pas le temps de se focaliser sur un personnage et ses émois… Même l’arrivé du phénix, normalement très calibrée, arrive à être foirée comme jamais !
Je n’ai rien contre le fait d’adapter un grand classique pour une nouvelle génération, mais là, faut quand même avouer que les rares explications sont survolées. Du coup, de nombreux détails laisseront les profanes sur leur faim, voire dans l’incompréhension la plus totale. Et le film joue aussi sur les clichés que Saint Seiya a véhiculés, et que seuls les fans peuvent apprécier. Du coup, si je comprends bien, c’est un film pour les ados mais qui cible les anciens fans trentenaires ?
Quel foutoir !
En bref, une cinématique d’une heure trente qui vous en mettra plein la vue. Cette nouvelle vision saura peut-être trouver un nouveau public. Les connaisseurs iront surement, mais seront déçus par le fait que le film ne soit qu’une synthèse ratée de leur œuvre préférée. En tout cas, s’il faut le voir, c’est bien au cinéma pour profiter d’une bande son géniale, d’un format Scope trop rare dans l’animation et d’une déferlante d’action jubilatoire.
Philippe Bunel
Les Chevaliers du Zodiaque, la Légende du Sanctuaire
(Saint Seiya Legend of the Sanctuary)
Sortie le 25 février 2015